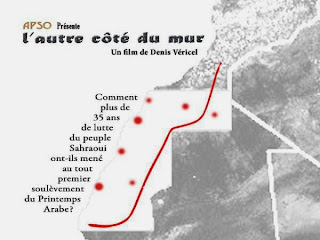Les origines
Par D.M. Chetti
A la croisée des chemins entre l’Afrique et l’Europe, la Méditerranée, l’Atlantique et le monde arabe, le Maroc a toujours eu une place spéciale dans la diplomatie occidentale et dans sa planification stratégique, spécialement américaine.
Cette situation s’est renforcée depuis les attaques terroristes du 11 Septembre 2001 jusqu’aux récentes inquiétudes liées aux printemps arabes et la montée des extrémismes islamiques en conséquence, donnant plus de valeur à la pertinence opérationnelle et stratégique de l’alliance américano-marocaine.
Cependant, depuis quelque temps, les relations du Makhzen semblent s’effriter avec l’apparition sur la scène politique internationale d’une nouvelle configuration géostratégique qui ne cesse de changer au niveau de sa ligne, selon les intérêts des grandes nations de ce monde.
Considéré par ces mêmes grandes nations comme le pays le plus stable, libéral et démocratique du monde arabo-musulman, le Maroc a également été un partenaire important dans la lutte contre le terrorisme et la poursuite de la paix au Moyen-Orient par le biais de ses relations privilégiées avec l’état sioniste d’Israël.
C’est à ce titre qu’il perçoit la plus importante aide étrangère américaine et l’armée américaine participe régulièrement à de grandes manœuvres axées sur la sécurité et destinées à renforcer les capacités de partenariat entre les deux pays.
Depuis le retrait espagnol suivi de l’occupation du territoire sahraoui par le Maroc en 1975, les Etats-Unis ont dépensé des millions de dollars en matériel et en formation des forces armées royales sans que ces dernières ne réussissent à infliger une défaite décisive au Front Polisario qui revendique une indépendance totale du Sahara occidental.
Et pourtant, même après des décennies marquées par la guerre, avec une implication militaire et diplomatique significative des Etats-Unis, aucune solution royale ne semble émaner pour régler le conflit avec les nationalistes sahraouis, à part chercher la nique au voisin, dont la ligne stratégique a toujours été d’une clarté biblique ne souffrant aucune ambiguïté depuis les années Boumediene jusqu’à ce jour.
Il n’en demeure pas moins que l’un des piliers de la légitimité de la monarchie marocaine, sa revendication du Sahara occidental, reste un point de violents contentieux. Mais revenons un peu en arrière et essayons de comprendre les événements d’une manière chronologique. Lors de la Conférence de Berlin de 1884 à 1885, l’ Espagne a fait valoir son droit à une large bande de territoire le long de la côte atlantique, au sud du Maroc actuel.
La demande est fondée au nom d’une petite entreprise commerciale espagnole à Dakhla, alors appelée Villa Cisneros, qui était une excroissance des installations mises en place il y a plusieurs années pour soutenir des opérations de pêche en provenance des îles Canaries. En 1912, la France et l’Espagne ont convenu de la frontière pour leurs possessions africaines du Nord-Ouest.
La France a pris l’Algérie et la Mauritanie et le contrôle de la plus grande partie du nouveau protectorat du Maroc.
Les zones espagnoles du protectorat marocain occupaient une partie de la côté méditerranéenne et ce qu’on a appelé le Sahara espagnol.
Légalement, le protectorat marocain n’était pas une colonie parce que le sultan avait une apparence de pouvoir, en réalité entre les mains de l’administration française et espagnole.
Le Sahara occidental était donc bien une colonie à part entière de l’Espagne
Le territoire du Sahara occidental constituait alors une superficie de 266.000 kilomètres carrés coincée entre la côte atlantique, le Maroc au nord, la Mauritanie au sud et l’Algérie à l’Ouest.
L’archipel espagnol des Canaries est à environ 100 km au large de la frontière sud marocaine.
Il n’est pas entièrement couvert de sable. Au nord, Es Saqiyah Al-Hamra est une profonde ravine et le Guelta Zemmour possède de fortes montagnes et de nombreuses grottes.
Au fil des ans, les caractéristiques géographiques de la partie nord du Sahara occidental vont faciliter les attaques de guérilla contre les forces marocaines en fournissant une couverture des mouvements insurrectionnels et un repli vers les nombreuses caches dans les montagnes Ouarkziz.
La côte atlantique est assez rude et bordée de falaises.
Les villes côtières comme Dakhla, La Guera et Laâyoune sont équipées de ports, mais il n’y a presque pas de tradition de pêche chez les habitants sahraouis.
Historiquement, les pêcheurs dans les eaux au large de la côte du Sahara viennent essentiellement des îles Canaries. C’est en octobre 1957 que le nouvellement indépendant Etat marocain adoptera officiellement l’idéologie du Grand Maroc et la dynastie alaouite jalonnera sa légitimité en partie sur la préservation de ses «Provinces du Sud», comme elle aime à dénommer le Sahara occidental.
L’attrait populaire de la notion de Grand Maroc explique bien pourquoi Rabat a résisté aux pressions extérieures en refusant de transiger sur la question, même après que les coûts militaires et financiers de l’occupation du territoire Sahraoui aient contribué lourdement à l’apparition de troubles sociaux au royaume.
Historiquement, la domination espagnole sur le territoire reposait sur un système relativement efficace consistant en la présence d’une force armée d’occupation et d’administration.
Malgré cela, les autorités espagnoles n’ont jamais réussi à comprendre comment l’évolution géographique et les conditions sociales ont fomenté la montée de la résistance nationaliste, en particulier parmi les jeunes Sahraouis.
Après le retrait espagnol du territoire en 1975, le Maroc a mené une campagne militaire brutale contre le Polisario et un grand nombre de personnes ont fui vers des camps de réfugiés. Conséquence : l’identité tribale traditionnelle s’est lentement effacée pour donner naissance à une identité et à une conscience nationale sahraouie.
Les ressources naturelles ont façonné la géographie humaine ainsi que les intérêts extérieurs du royaume chérifien.
L’expansion du Maroc au Sahara occidental lui a permis bien évidemment de les exploiter pleinement avec un désir de développer le potentiel économique nouveau consistant en d’importants gisements de phosphates, de la pêche et d’une potentielle d’exploitation pétrolière.
Comme composante de l’identité nationale marocaine, la croyance que le Sahara occidental fait partie intégrante du Maroc a bénéficié du soutien interne généralisée, bien que les coûts humains et financiers de la guerre contre le Polisario a également eu un impact négatif sur sa popularité.
Alors que le président algérien feu Houari Boumediene proposait que les trois pays soutiennent le mouvement de libération du peuple sahraoui en collaborant pour expulser l’occupant espagnol du Sahara occidental, le roi Hassan II préférait voir les Espagnols rester que d’avoir un Etat indépendant sous la tutelle algérienne.
Lors de la rencontre de juillet 1973 entre les trois chefs d’Etat, Hassan II accusera directement l’Algérie d’avoir trahi sa parole. Et pourtant, l’Algérie a fait comprendre à plusieurs occasions et d’une manière officielle au Maroc qu’elle ne réclamait pas le Sahara, ni une partie du Sahara occidental.
Lors des négociations entre le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et l’Espagne à propos du Sahara en 1973, Hassan II imposa sa position selon laquelle «le Sahara doit être marocain, à défaut, il reste espagnol, mais il ne sera jamais ni algérien ni indépendant».
C’est ce qu’ont révélés plusieurs télégrammes diplomatiques américains rendus publics récemment par Wikileaks
En réalité, du point de vue géostratégique, il faut considérer le Sahara occidental comme une zone tampon pour le Maroc. La perspective d’un Sahara indépendant ou sous l’influence algérienne est à ce point inenvisageable qu’il promettait déjà de faire la guerre si cela devait se produire.
Sa crainte c’est que si l’Algérie s’en saisissait ; le royaume serait enclavé, donc plus faible et vulnérable aux pressions algériennes.
Le roi Hassan II n’aurait jamais pu tenir ce genre de discours belliqueux si les Etats-Unis ne lui avaient pas fourni l’assurance et le soutien nécessaire pour faire la guerre.
C’est d’ailleurs ce que révèle Henri Kissinger dans ses mémoires, l’Amérique voulant empêcher une zone d’influence communiste aux portes du palais.
L’Echo d’Algérie, 21/12/2013