Pocos lugares tan atrayentes y mágicos para la creación literaria como el desierto. Y qué decir del territorio del Sahara Occidental, del que España fue potencia colonizadora durante cien años. Porque en el Sahara no sólo hay desierto de arena, hay bellísimas costas atlánticas, faros, viajeros, mitos y leyendas, sorprendentes montañas y cuevas mágicas, eruditos y sabios. Sin embargo, a pesar de tantos atractivos para la creación, en esta breve revisión de la influencia de la cuestión saharaui en la literatura española veremos que tras un siglo de historia común, y 35 años transcurridos desde el abandono del territorio, no hay demasiada literatura española que se haga eco de la que fuera nuestra provincia 53.
Durante el periodo colonial, mientras España estaba aún en el territorio, no hubo apenas escritores interesados en reflejar aquella época. La estancia española en sus colonias africanas fue breve, lo que no permitió que hubiera varias generaciones de colonos nacidos y criados en los territorios africanos (como ocurrió en el caso de la Argelia francesa). En la época se editaron varios libros, fundamentalmente escritos por militares, centrados en temas como la geografía, los pozos, fauna y flora, Historia o Antropología. Hay que tener en cuenta que hasta los años 60 la gran mayoría de población “europea” del territorio estaba compuesta por militares y que el Sahara Español, en palabras del periodista Pablo Dalmases, siempre se gobernó “como un cuartel”. Los militares, además de ser quienes vivían en la colonia, la conocían en profundidad gracias a sus patrullas con las Tropas Nómadas. Muchos de ellos convivieron también con los beduinos y pudieron conocer las costumbres y formas de vida saharaui de forma directa.
Si hablamos de creación literaria, durante la época colonial apenas hubo producción española inspirada o ambientada en el Sahara. Al parecer el primer libro de narraciones sobre el Sahara Español fue “Horas en el Sahara”, de Rafael de Guzmán (1953), que recoge las vivencias del autor, un funcionario español en La Güera (sur del Sahara), con una cierta mirada de superioridad hacia lo saharaui. O la “rareza” que constituye la novela rosa ambientada en el Sahara “Naufragio en la luna de miel”, de Enrique R. Fariñas (1957), de un orientalismo tirando a rancio. Más allá de la mera anécdota encontramos “Arena y Viento” de Alberto Vázquez-Figueroa (1961), donde el autor narra sus vivencias de adolescencia y juventud en el Sáhara español, y su descubrimiento del fascinante continente africano.
Y no mucha más producción en aquellos años de la metrópoli, podemos destacar “Trópico de ausencia”, de Antonio Segado del Olmo (1973) definida como una “novela rara en la época, crítica con las penumbras de la vida colonial”.
Como hemos mencionado anteriormente, los militares que escribieron sobre el Sahara durante la época colonial lo hicieron fundamentalmente en el campo de la investigación: geografía, antropología e historia, pero hubo militares que llegaron incluso a publicar poesía. Es el caso de Julio Martín Alcántara y su “Romacero saharaui” de 1950:
“De Güera a Villa Cisneros / De Cabo Jubi a Tantán…/ Ay, amor, / Yo no sé si serán más / las arenas del desierto / o las espumas del mar”.
Otro poemario de la época colonial es “La arena y los sueños”, del también militar Luis López Anglada, publicado en 1972. Su poema Hombres azules dice así:
Desde los territorios de la nada, / donde el silencio impone el vasallaje; / del reino del silencio y del salvaje / término de la sebja calcinada.
Alcántara y López Anglada elaboran una poesía que incorpora elementos de la idiosincrasia saharaui: geografía, palabras en hasania, fruto de su conocimiento del territorio y sus habitantes.
Una vez consumado el abandono del pueblo saharaui y su entrega a Marruecos, se abrirá el camino a una literatura postcolonial de contenido más humanista y existencialista. En España aún se esperaron unos años tras la transición para dirigir la mirada al Sahara. Los libros actuales sobre esta temática tratan de integrarse con los anhelos de los mismos saharauis, y se escribe desde un plano de no superioridad. Es esta una literatura, en muchas ocasiones, de fuerte compromiso político y emocional con el pueblo saharaui, con cierta mala conciencia, tal vez aún queda algo de paternalismo, del que no nos hemos desprendido. Hay que destacar también que el lenguaje se ve enriquecido con términos del hasania. Aún sigue habiendo una fuerte presencia de títulos escritos por militares, ya dentro de la creación literaria. Eso sí, en general hay aún escasa ficción, hay aún demasiadas memorias, ensayos y libros de enfoque político y periodístico[1].
Con respecto a la nueva mirada “postcolonial” que aparecerá en las antiguas metrópolis, traigo esta cita del profesor marroquí Nizar Tajditi: “El sueño del desierto sigue conservando en los nuevos escritores mediterráneos su encanto y atractivo, pero se ha convertido en un sueño abierto, es decir, un sueño que busca integrarse en los sueños de los habitantes del Sahara y convivir con ellos en un amplio marco imaginario cultural y humano en el que no exista discriminación entre etnias superiores e inferiores. Lo que cuentan o describen ese tipo de escritores europeos «postcoloniales» se acerca mucho a lo que cuentan, o tienden a contar, los escritores magrebíes respecto al sueño del desierto”[2].
Adentrándonos en la poesía quiero recordar dos poemarios publicados en los años 80 inspirados en la temática saharaui, destacando que ya en esa fecha se había consumado el abandono de la metrópoli a la provincia. Uno ellos es la antología poética “Os doy esto desnudo que es mi mano” (1986), impulsada por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui a partir de un viaje de varios escritores españoles a los campamentos de refugiados. Fue uno de los primeros libros solidarios de apoyo a la causa saharaui, en el que aparecieron escritores como Jorge Guillén, Alfonso Sastre o José Agustín Goytisolo, entre muchos otros. La escritora canaria Maribel Lacave publicó en 1988 el poemario “Donde sólo media luna”, dedicado en su totalidad al pueblo saharaui.
Jugaremos al aire / por las playas de Dajla / y en un instante / volarás al mañana. / -¿Qué es el mar? / El mar, pequeño mío, / es toda la patria liberada.
En ambos poemarios, “Os doy esto desnudo que es mi mano” y “Donde sólo media luna”, predomina una poesía combativa y militante a favor de la causa saharaui, una vez consumado el abandono.
Maribel Lacave, que pasó su niñez y juventud en el Sahara, publicó en años posteriores el libro “Los mundos de Gali” (2008) sobre el programa Vacaciones en paz, y el poemario “Isla Truk” (2011), dedicado a la isla Herne de la península de Dajla, antiguo Villa Cisneros. Este poemario está realizado junto a la escritora y editora canaria Mª Jesús Alvarado, quien también pasó su infancia en Villa Cisneros. Alvarado, autora del libro “Suerte Mulana” (2002), recopilación de recuerdos de su infancia saharaui, ha sido además editora e impulsora de diferentes publicaciones del grupo de escritores saharauis Generación de la Amistad.
Me gustaría reseñar un libro muy curioso. Se trata del poemario “El sueño de Dakhla. Poemas de Umar Abbas”, de Manuel Moya, (2008). En un juego de personalidades, el poemario es atribuido a un poeta saharaui de nombre Umar Abass. Los poemas hablan del exilio, de la tierra perdida, desde una atmósfera intimista. Al mismo tiempo el autor se inspira para varios poemas, en la obra de poetas saharauis en español, Ali Salem Iselmu y Mohamed Ali Ali Salem, de la Generación de la Amistad Saharaui.
Me sé atrapado, compañera / por eso debo masticar cada mañana / la sal y el cuerpo sin sombra del exilio, / las nubes que a la demencia me empujan, / el viejo sueño de despertar en Dajla.
Una obra para mí muy especial es “La zancada del deyar”, de Gonzalo Moure (2004). Se trata de un libro de viajes que incluye muchos ingredientes de antropología y tradiciones saharauis, fruto de lo recogido por el autor en su convivencia con los nómadas en los territorios liberados. El autor llega hasta la mítica tierra de Tiris, y hace referencia a importantes personajes de la Historia saharaui, como el erudito Chej Mohamed El Mami.
Gonzalo Moure es además autor de varios libros de literatura infantil y juvenil de temática saharaui, como “El beso del Sahara” (1998), “Palabras de Caramelo” (2002) y “Los gigantes de la luna” (2003). Hay que destacar que en los últimos años ha surgido una floreciente y extensa literatura infantil y juvenil española de temática saharaui. A los libros de Gonzalo Moure hay que unir “El color de la arena” de Elena O’ Callaghan, “El cazador de estrellas” de Ricardo Gómez (2003), o “La puerta trasera del paraíso” de Luis Leante (2007). A través de esta literatura se lleva la causa y cultura saharaui a colegios e institutos, y por sus características de solidaridad, exotismo y ternura, tienen una gran aceptación entre niños y jóvenes.
Un bello libro es “El mapa de la espera”, de Ana Rossetti (2010), lleno de poesía y esperanza, que sin ser para niños es para todos los públicos. Escrito para apoyar el proyecto Bubisher, han dicho de él que “es un bello mapa para salir del exilio y soñar un futuro mejor”[3].
En lo que se refiere a la novela, después de la salida de España varios militares publicaron libros basados en sus experiencias y las de sus compañeros durante su estancia en el Sahara. Es el caso de “Smara” de Fernando Mata (1997), “Siroco. Recuerdos de un oficial de Tropas Nómadas” de Mariano Fernández-Aceytuno (1996), “Mientras soñaba, al oeste del Sahara” (2004) y “El Juramento (Al-Kasám)” (2005) de Agripín Montilla o “Morir por el Sahara” de Julián Delgado (2009). En una reseña sobre uno de estas novelas se afirma “después de haber callado durante mucho tiempo por su condición de militar, ahora decidió escribir un libro con todas esas vivencias”[4]. Se trata de obras que mezclan realidad y ficción. Por lo general los personajes de ficción son fiel reflejo de aquellos que protagonizaron el hecho histórico, procurando sus autores hacerlos lo más verosímiles posible teniendo en cuanta su experiencia personal. Una de las características comunes de estos libros es que están escritos en muchas ocasiones para exorcizar esa mala conciencia que invadió a muchos de los militares que estuvieron destinados en el Sahara y que no estuvieron de acuerdo con la forma en que se desarrolló la salida del territorio saharaui. En todos ellos se repiten varias características: revisión nostálgica de la vida militar, recuerdo emocionado de las jornadas vividas en las patrullas por el desierto, buena relación con los saharauis que formaban parte de la tropa y cariño hacia un pueblo que consideran abandonado a su suerte por los propios españoles. En todos ellos también se habla en general con corrección y comprensión por los saharauis que se levantaron en armas por la independencia de su patria.
Fuera del ámbito militar quiero destacar las novelas de Emilio González Déniz, considerado el “novelista español que más atención ha dedicado al conflicto del Sahara Occidental con dos novelas: “El llano amarillo” (1985) y “Sahara” (1995), dos libros que se complementan, influidos por las vivencias del autor, que pasó la mili en el Sahara y fue amigo de saharauis que militaron en el Frente Polisario. Se considera la obra de González Déniz como “un recordatorio de una especie de deuda histórica que España tiene sin saldar”[5]. De “El llano amarillo”, una larga epístola donde se cuenta la historia de tres amigos envueltos en el conflicto saharaui es este fragmento:
“La dureza del clima sahariano los protege de los que ansían su exterminio. El miedo que los otros tienen al desierto les salva. Por eso los saharauis aman el Sahara”.
Otra gran novela sobre el Sahara es “El imperio desierto”, de Ramón Mayrata (1992). En este caso se unen un magnífico escritor y su conocimiento directo de los hechos que se están narrando. La novela recorre los últimos años de estancia de España en el territorio y los acontecimientos que desembocaron en el abandono del pueblo saharaui a su suerte. Mayrata vivió en primera persona aquellos cruciales momentos como miembro de una comisión de estudios históricos.
“Durante años obligaron a los saharauis a decir sólo aquello que ellos querían escuchar (…) Los colonizadores no sólo imponían una realidad ficticia al pueblo colonizado. Acaban creyendo en ella”.
“El médico de Ifni” (2005), de Javier Reverte, es otra novela que tiene como escenario el Sahara. El autor también participó con un poema en el libro “Os doy esto desnudo que es mi mano”, que ya hemos mencionado, y ha realizado varias crónicas relacionadas con los saharauis, publicadas en sus libros de viajes.
Un ejemplo de cómo la literatura puede ayudar a llevar la causa saharaui muy lejos es la novela de Luis Leante “Mira si yo te querré”, Premio Alfaguara de Novela 2007. La novela alcanzó unas cifras de ventas bastante importantes y fue traducida a varios idiomas, incluido el chino. La fuerza de una editorial potente y un premio literario llevó a los saharauis a diferentes países europeos, latinoamericanos y a EEUU. En palabras del propio Leante: “No voy a ser tan ingenuo de pensar que la literatura o yo podemos despertar la conciencia de los políticos porque eso es imposible, pero me sentiré contento si logro conmover y despertar el interés de la gente sobre este problema”[6]. El jurado que le concedió el premio, entre ellos Mario Vargas Llosa, destacó “la fuerza expresiva con que se describen los paisajes y la vida de la última colonia española en África”.
En cuanto a libros realizados desde una perspectiva femenina, escritos por mujeres y sobre mujeres, destaco “Hijas de la arena” de Ana Tortajada (2002), que narra desde la perspectiva de las mujeres saharauis, la vida en los campamentos, a partir de un viaje que hace la autora. Y el cuento de Lucía Etxebarria “Sin tierra”, aparecido dentro de su libro “Una historia de amor como otra cualquiera” (2003), se centra en la condición de la mujer en el Sahara, a través de las reflexiones de una joven refugiada saharaui que regresa a los campamentos tras estudiar en Cuba.
“Para entender mi historia tienes que entender la historia de mi pueblo, porque todo lo que yo he hecho y todo lo que soy no se entiende sin saber de dónde yo vengo.(..) salí de allí en el vientre de mi madre, y nací en esta tierra que no es mi tierra, porque ésta no es la tierra de mis padres, porque en esta tierra no están enterrados mis antepasados. Esta no es tierra de nadie”.
No querría olvidar otro “género” dentro de esta literatura española de temática saharaui, que es la literatura del movimiento solidario. Es el caso de “Los 54 tés en casa de Jaiduma” del periodista y escritor César Rufino (2011), que muestra una mirada sobre la acogida de los niños saharauis y los viajes a los campamentos de refugiados. En esta línea se encuentran “Las Jaimas de Ard El Gammar” de Francisco Javier Prada Fernández (2002), “Atrapados en Tinduf” (2004) de Eduardo Jordán, o “Los otros príncipes” de Conchi Moya (2009). En todos ellos el viajero describe sus experiencias con los refugiados saharauis.
De este movimiento solidario también han salido otras experiencias literarias como “Si tú supieras”, libro de relatos de Antònia Pons (2011) definido como “una defensa de la libertad y un grito contra la opresión en su forma más bella, a través de breves pero intensos relatos” o “Delicias Saharauis”, de Conchi Moya (2009), libro que se introduce en el mundo de los saharauis, sus tradiciones, historias, leyendas eruditos y sabios e historias personales que han llegado especialmente a la autora.
Conchi Moya; intervención en la Mesa Redonda « La cuestión saharaui y su recepción en la literatura española », en el I Seminario sobre Literatura Saharaui. Encuentro de escritores de la Generación de la Amistad. Universidad de Alicante, 23 y 24 de septiembre de 2011.
[1] Notas sobre intervención del militar y escritor Julián Delgado; Mesa redonda: “Cultura saharaui”. V Jornadas Universidades Públicas Madrileñas con el Sahara Occidental. 11 y 12 de mayo de 2011en Madrid.
[2] “El sueño del desierto en la literatura magrebí”, de Nizar Tajditi. Ponencia presentada con ocasión de la mesa redonda Literatura y desierto, organizada por Casa Árabe en la Feria del Libro de Madrid el 31 de mayo de 2007.
[3] Juan Velasco Moreno
[4] Sobre el libro “Mientras soñaba… (al oeste del Sahára)”, de Agripín Montilla
[5] “La novela colonial hispanoafricana”. Antonio M. Carrasco González.
[6] Entrevista de Luis Leante a EFE; 1 de agosto de 2007






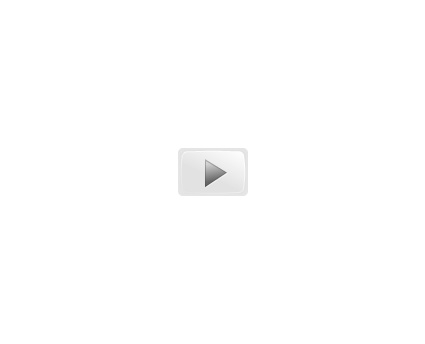 st1\:*{behavior:url(#ieooui) } <![endif]–>
st1\:*{behavior:url(#ieooui) } <![endif]–>

