Mois : mai 2011
-
Sahara occidental : L’histoire et la situation actuelle au menu d’une rencontre à Rome
Le Sahara occidental, l’histoire de ce territoire, son statut juridique, sa situation actuelle au niveau politique, social, économique, humanitaire et la question des droits de l’Hhomme, seront, aujourd’hui, au centre d’une rencontre d’experts à Rome, a-t-on appris auprès des organisateurs. Organisée par l’Observatoire méditerranéen d’anthropologie et de géopolitique (O.Me.GA), la rencontre, qui regroupera des universitaires et historiens, mais aussi des juristes et des représentants d’ONG de solidarité avec le peuple sahraoui, vise à promouvoir la sensibilisation de l’opinion et des médias sur un problème de décolonisation reconnu par les Nations unies.Les universitaires invités à animer des conférences spécifiques, se pencheront notamment, sur le statut juridique du Sahara occidental, son histoire, sa situation actuelle et les droits de l’Homme dans les territoires occupés, a-t-on indiqué. En outre, les conférenciers débattront de la situation des réfugiés sahraouis, vivant « dans des conditions précaires », selon la même source, qui a ajouté qu’au cours de cette rencontre, seront examinés « les aspects politiques, anthropologiques de la question du Sahara occidental ».Les universitaires participant à cette journée dédiée à un territoire reconnu « non autonome » par les Nations unies, mais occupé par le Maroc depuis plus de 35 ans, issus de différentes universités italiennes, notamment des régions du Latium, d’Emilie-Romagne et de Toscane, discuteront également, de « la position » du pays occupant ce territoire. La question sahraouie prise en charge par les Nations unies, qui peine à lui trouver une solution passant par le respect du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, a fait l’objet de nombreuses rencontres informelles entre les autorités marocaines et les autorités sahraouies, qui n’ont pu faire sortir le problème de l’impasse.Le Midi Libre, 10/05/2011 -
Le printemps du Maroc
Au Maroc, la révolte est connue sous le nom du mouvement du 20 février, date de la première manifestation. Elle rassemble des étudiants, des chômeurs et des fonctionnaires. En tête de liste de leur revendication, on trouve plus de démocratie, de liberté et de justice sociale.Comme d’autres dirigeants de la région, le roi Mohammed VI, fait des promesses de changement (le 9 mars) tout en réprimant par la force les manifestations (le 13 mars). C’est au cours d’un discours qu’il s’est engagé à mettre en place une commission consultative en vue de réformer la constitution. Le résultat des travaux devraient être livrés vers le 15 juin. Il a également promis de renforcer l’indépendance de la justice et la séparation des pouvoirs. Le 14 avril dernier, il a fait libéré 93 prisonniers politiques parmi lesquels des islamistes et des Sahraouis.
Sauf que les manifestants n’y croient pas et continuent à le dire. Le 24 avril, ils sont ressortis dans la rue pour réclamer un ‘Maroc nouveau’. Là encore, le gouvernement a tenté l’apaisement avec l’annonce d’augmentation de salaires et de retraites. Le lendemain, c’est l’attentat sur une des places principales de Marrakech qui fait 16 morts. Il sera attribué à des islamistes. Pour le Mouvement du 20 février, c’est l’occasion de protester contre le terrorisme en même temps que plus de liberté.
En 1989, la chute du mur de Berlin avait provoqué la révolte en chaine en Europe de l’Est en même temps que la dissolution du bloc soviétique. Qu’en sera-t-il du printemps qui secoue actuellement le Moyen-Orient ?
Excite, 08/05/2011
Source Photo : Magharebia (flickr.com) -
Sahara occidental: Un conflit « oublié » – soirée-débat au cinhoche le 12 mai
A l’initiative de l’AFASPA et de l’Appel des Cent pour la PaixDès 19 heures : accueil autour du bar et de l’expo de portraits photo d’Hervé De Willencourt : La guerre, l’exode , l’oubliA 20 heures , projection du film: « Une République en exil » de Cheikh Djemaï,puis débat animé par Michèle Decastère, secrétaire générale de l’AFASPA*avec: Bachir Moutik représentant les familles de prisonniersFrance Weil, avocate « Droit et liberté »*AFASPA: Association Française d’Amitié et de Solidarité avec les Peuples AfricainsA l’heure du soulèvement de tout le Monde Arabe, certain pays sont étrangement passés sous silence. Le Maroc fait ainsi figure d’exception aux yeux des médias internationaux alors même que des manifestations historiques ont eu lieu et que la répression a encore une fois été très violente de la part des autorités marocaines.Mais plus encore que le soulèvement de la population marocaine, c’est celui des Sahraouis qui est étouffé. Dans de récents entretiens à propos des événements dans les pays arabes, Noam Chomsky est revenu sur l’origine de cette révolte et a placé les protestations des Sahraouis en novembre dernier et la destruction du camp de protestation de Gdeim Izik par les forces paramilitaires marocaines, comme le point de départ de tous les soulèvements.Depuis bientôt cinq mois, la résistance sahraouie est passée à une nouvelle étape et les manifestations se multiplient sur tout le territoire. Tout comme les voisins tunisiens, algériens, égyptiens et libyens, les opprime, qui ne leur laisse aucun accès au travail, au logement et à une vie décente. Mais plus encore qu’ailleurs, les Sahraouis protestent contre une autorité qui les gouverne injustement et illégalement. Dans la dernière colonie d’Afrique, les Sahraouis attendent encore 20 ans après le cessez-le-feu que le référendum promis soit enfin mis en place.Et si les médias ont quelque peu parlé des événements de novembre au Sahara Occidental, les manifestations qui se poursuivent sont tout bonnement passées sous silence. Pourtant, à El Aaiun, à Dakhla, à Smara et dans toute la zone occupée, la résistance ne fléchie pas et continue sa lutte malgré la répression policière, militaire, et même les attaques par les colons marocains sur les civils sahraouis et leurs biens.Source : Les Verts de Bagnolet, 09/05/2011 -
UNE VIGIE CONTRE L’OUBLI
Jean-François Debargue ne cesse de crier « Au secours !!! » au nom de la cause des Sahraouis, réfugiés en Algérie.Ses différents témoignages sont « assourdissants » tant l’injustice des décisions prises contre ce peuple par la majorité des pays occidentaux (dont la France) révèle une autre image que ce que prétendent le plus souvent nos politiques.Pourquoi rien ne bouge au Sahara occidental, dernière colonie d’Afrique, depuis plus de 3 décennies ?Il est important de lire ce livre qui met en évidence une réalité qui a déjà fait tant de morts par le passé …..Voilà juste un an que l’actualité m’avait fait connaître cette scandaleuse affaire qui met à genoux des milliers de familles dans la plus grande ignorance de notre monde moderne, portant réputé pour ses moyens de communications ….. performants.Dans le numéro de Mai 2011 « MESSAGES » du Secours Catholique, Clémence RICHARD redonne la parole à ce Français, Jean-François Debargue, qui s’est mis en quatre pour tenter de faire bouger notre Ministre des Affaires étrangères, n’hésitant même pas sur la nécessité de faire une grève de la faim en 2009.En décembre 2010, Médiapart témoignait à son tour sur cette ignominie qui contraint des milliers d’enfants à vivre sous une tente sans aucun aménagement sanitaire. La répression y est toujours aussi féroce :Des dizaines de militants sont aujourd’hui en prison au secret, sans être déférés ni assistés d’avocats ; on ne sait rien des tués ni des blessés, et, sans doute, de plusieurs autres dizaines de personnes, toujours portées disparues, etc.
Cette situation nous impose de réagir, et d’être plus nombreux et de disposer de davantage de moyens d’informations, afin de soutenir ce peuple que le royaume voisin annexe par la colonisation forcée et la militarisation, en dépit des dispositions de l’ONU qui a statué pour la mise en place d’un référendum sur l’autodétermination.Mais rien ne semble émouvoir les pays voisins ayant forcément connaissance de ces conditions terribles, identiques à celles qui sont imposées par ailleurs aux enfants palestiniens.Vingt jeunes sahraouis qui ont participé il y a cinq mois dans le camp de Gdeimlzik, ont décidé d’entrer en grève de faim à partir du mardi 19 avril pour protester contre les dures conditions d’emprisonnement et pout alerter la communauté internationale sur leur situation. Nous joignons ci-après leur communiqué.Si je suis considéré une fois de plus pour un PARANO parce que je souhaite faire connaître plus largement cette injustice ….. tant mieux !!!! car je préfère cela que d’être un lâche.Tous ceux qui auront lu mon message ne pourront plus dire :On ne savait pas !!!!! -
Camps de réfugiés sahraouis : la tragédie diplomatique a trop duré
A plus de 35 degrés, perfusion de thé sucré pour tenir le choc de la réalité politique qui détermine le quotidien sahraoui, les coulisses diplomatiques qui conditionnent leur attente absurde, entre cinéma et cour de relations internationales.A Dakhla, on ne compte que l’essentiel. Les bombonnes de gaz et les sacs de farine envoyés par les ONG étrangères ou le Haut Commissariat des Réfugiés (HCR), le nombre d’années passées en exil, depuis que le Maroc s’est emparé de ce qui était encore le Sahara Espagnol et qui est devenu les “territoires occupés” pour les Sahraouis. 35 ans.Là-bas, on compte le nombre de jours de grève de la faim des prisonniers politiques, sanctionnés pour avoir installé un camp pacifique de 6 000 khaimas (tentes) à côté d’El Ayoune. Pour le reste, on partage sans compter turpitudes et bonne humeur.Les fonctionnaires ne comptent pas sur leur salaire, 30 euros par mois, les jeunes époux ne comptent pas les dépenses du mariage, 4 000 euros pour Salek Alamin Baha, fondateur des Brigades volontaires Nayem el Garhi qui proposent des activités extra-scolaires aux jeunes. On ne compte pas non plus les années loin du pays, Cuba, Algérie, Libye, seul moyen de suivre des études supérieures.Les festivaliers ne comptent pas les gestes d’hospitalité des familles qui les accueillent dans leurs khaimas plus ou moins garnies, ni les instants de prise de conscience qui ponctuent leur semaine dans le camp de réfugié de Dakhla.Ah bon, c’est la France qui use de son veto pour empêcher la mission des Nations Unies (Minurso) de veiller au respect des droits de l’homme ? Ah bon, le droit international affirme depuis 35 ans que les Sahraouis ont droit à un référendum d’autodétermination ? Ah bon, on se douche au seau ici ? Ah bon, 52% des enfants de moins de 5 ans et 67% des femmes enceintes du camp de réfugiés souffrent d’anémie ?“La politique est souvent ennuyeuse à mourir, c’est pourquoi il est bon d’avoir des initiatives comme le festival de cinéma Fisahara, qui parlent de manière joyeuse et créative de sujets politiques aussi importants.” Francisco Bastagli, ex-envoyé spécial des Nations Unies en 2005-2006 invité par le festival a eu du nez. Il en a aussi quand il sent “un manque d’information ou une mauvaise information sur le Sahara Occidental.”Sur la place principale, les Sahraouis des 4 autres camps (qui ont repris les noms des villes du Sahara Occidental, El Ayoune, Smara, Awserd…) affluent en Mercedes achetées en Mauritanie ou en 4/4 pour prendre part à la fête. Luis Tosar, meilleur acteur des Goyas en 2011, fait le signe de la victoire entouré de militants des “territoires occupés” présents malgré le risque de persécutions à leur retour.On est loin des discours engagés livrés dans l’ambiance feutrée du festival de Cannes. Le soir, après Tambien la lluvia, Pan Negro ou Entrelobos, trois films espagnols contemporains récompensés aux Goyas, projetés en compagnie des acteurs Luis Tosar, Carlos Bardem et Nora Navas, on regarde des courts-métrages sud-africains qui délivrent des messages de tolérance et d’inquiétude, puis on va dormir à la belle étoile.Pour bien dormir, on pense à l’unique lueur d’espoir délivrée par Francisco Bastagli :”Il y a un malaise grandissant en Europe sur cette question qui pourrait briser le monopole exercé par les soutiens du Maroc (France, Etats-Unis, etc.) L’Allemagne, l’Irlande, les pays scandinaves; l’Autriche commencent à s’indigner. Ce n’est pas seulement une question de droits de l’homme mais aussi l’exemple type de prévention de conflit. On ne peut plus rester comme ça en refusant de voir un problème qui ne peut se résoudre seul. C’est une question de stabilité pour le Maghreb.” -
« Acheter nos ressources, c’est nos douleurs, souffrances et larmes »
Au cours de la semaine dernière, des Sahraouis victimes de graves violations des droits de l’homme ont pris les rues d’El Aaiun, réclamant davantage de respect de leurs droits socio-économiques. Les manifestants portaient des slogans attirant l’attention sur le pillage continu par le Maroc des ressources naturelles sahraouies, avec la complicité d’intérêts étrangers. « Le Maroc nous a fait souffrir des douleurs inimaginables, parce que nous sommes Sahraouis », soupire Ahmed (dont le nom n’a pas été demandé, afin de le protéger de toute mesure de représailles). « On nous avait promis une indemnisation, mais nous n’avons jamais rien reçu. Et ce qui est pire: les ressources naturelles de notre pays devrait en théorie suffire à atténuer notre fardeau, mais elles sont bradées pour remplir le trésor marocain – ajoutant l’insulte à la blessure ».Pendant plusieurs jours, les sahraouis ont manifesté devant le bureau local du Conseil national pour les droits de l’homme – précédemment surnommé le Conseil consultatif des droits de l’homme – à El Aaiun, la capitale du Sahara Occidental occupé. Presque tous les manifestants sont victimes de graves violations des droits humains, et demandent le respect de leurs droits sociaux et économiques.« Nous ne pouvons pas comprendre comment l’Union Européenne pourrait accorder au Maroc un
Statut spécial », dit un autre manifestant qui a demandé à rester anonyme. Plusieurs manifestants portaient des banderoles dénonçant la décision de l’UE d’attribution au Maroc le statut de partenaire privilégié. « Le Maroc continue d’occuper nos terres, nous traite comme des animaux, et il est récompensé pour cela? Je ne comprends pas … « «J’ai perdu mon bétail alors que j’étais dans la prison secrète de la Pecicimi (El-Aaiun) « , dit L.B. « À cause des coups reçus et des privations, j’ai perdu ma capacité à travailler. Je peux à peine à survivre « .La plupart des manifestants ont des histoires similaires. Ils ont été victimes de disparitions forcées, d’enlèvements, de détentions arbitraires, de torture et d’autres traitements inhumains, et ont eu beaucoup de difficulté à recommencer à vivre après leur épreuve. Leurs revendications en matière de réparation socio-économique sont restées sans réponse, et ils n’ont obtenu aucune forme de compensation financière ou administrative pour leur situation désespérée.Les revendications de centaines de sahraouis ont été reconnues par la Commission équité et réconciliation (IER), mise en place en 2004 afin de concilier les victimes de violations des droits de l’homme commises par l’Etat du Maroc sous le règne de l’ancien roi Hassan II. Les sahraouis, ayant beaucoup souffert pendant la guerre et sous la période ultérieure de l’occupation marocaine, ont répété pendant des années que l’IER les avait complètement oubliés. Alors que des dizaines de Sahraouis ont été convoqués devant le bureau de la Commission d’El-Aaiun, aucun d’eux n’a reçu d’indemnisation pour les lourdes pertes et les traitements inhumains qu’ils ont souffert.WSRW a reçu une liste de centaines de sahraouis dont le droit à compensation a été reconnu par l’IER. Mais pendant des années, cette liste est restée sur le bureau du Premier ministre, en attente de l’approbation.Les manifestants disent leur volonté de continuer à manifester aussi longtemps que les autorités marocaines refuseront de répondre à leurs demandes légitimes. «Nous voulons une juste compensation pour les dommages physiques et psychologiques que nous avons subis. Un partage équitable de l’exploitation de nos terres pourrait aller dans ce sens, mais même ceci nous est pris», disent-ils.SaharaDoc, 08/05/2011 -
La Commission Européenne n’a pas présenté d’information sur une consultation des Sahraouis
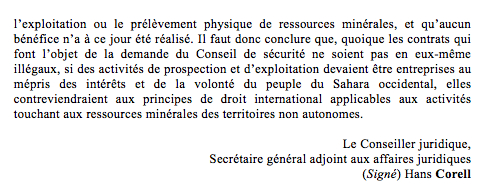 Il n’existe aucun moyen pour les Etats membres de l’UE de savoir si la pêche de l’UE au Sahara Occidental s’accorde avec les souhaits du peuple du territoire, tel que prescrit par le droit international.Le gouvernement britannique a déclaré que la Commission européenne n’avait transmis aucune information sur la concertation avec le peuple Sahraoui concernant la pêche de l’UE dans les eaux du Sahara Occidental. Ceci a été relevé par Richard Benyon, Secrétaire d’État, Département de l’environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA), le 4 mai 2011. »La Commission européenne n’a renseigné DEFRA d’aucune information concernant la consultation avec le peuple Sahraoui sur l’accord UE-Maroc de partenariat dans le domaine de la pêche. La Commission a transmis renseignements soumis par les autorités marocaines sur la manière dont les fonds alloués par l’UE pour l’Accord de partenariat de pêche avec le Maroc ont été utilisés. DEFRA procède toujours à l’évaluation de ces informations pour voir comment la population du Sahara Occidental en a bénéficié « .La déclaration répond à la question suivante du parlementaire Mark Williams (libéral démocrate), « de demander au Secrétaire d’État à l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales l’évaluation qu’elle a faite de la preuve présentée par la Commission européenne sur la question de savoir si le peuple sahraoui ont été consultés sur leurs souhaits concernant l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche UE-Maroc. »Le bureau juridique des Nations Unies a conclu que les activités sur les ressources naturelles au Sahara Occidental sont en violation du droit international si les Sahraouis n’ont pas été consultés.Télécharger ici l’avis juridique de l’ONU. Lire les conclusions sur la droite.Les services juridiques du Parlement Européen, et l’auteur de l’Avis juridique de l’ONU ont reconnu que la pêche de l’UE est illégale, puisque la volonté des Sahraouis n’a pas été prise en compte.Plus de 100 résolutions de l’ONU, et la Cour internationale de justice, répètent le droit du peuple Sahraoui à l’autodétermination et, dans ce cadre, à la souveraineté sur ses ressources naturelles. En 2010, la Cour a répété le droit des peuples colonisés (non autonomes) à l’autodétermination, dans son avis consultatif sur l’indépendance du Kosovo.WSRW, 6 mai 2011.SaharaDoc, 08/05/2011
Il n’existe aucun moyen pour les Etats membres de l’UE de savoir si la pêche de l’UE au Sahara Occidental s’accorde avec les souhaits du peuple du territoire, tel que prescrit par le droit international.Le gouvernement britannique a déclaré que la Commission européenne n’avait transmis aucune information sur la concertation avec le peuple Sahraoui concernant la pêche de l’UE dans les eaux du Sahara Occidental. Ceci a été relevé par Richard Benyon, Secrétaire d’État, Département de l’environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA), le 4 mai 2011. »La Commission européenne n’a renseigné DEFRA d’aucune information concernant la consultation avec le peuple Sahraoui sur l’accord UE-Maroc de partenariat dans le domaine de la pêche. La Commission a transmis renseignements soumis par les autorités marocaines sur la manière dont les fonds alloués par l’UE pour l’Accord de partenariat de pêche avec le Maroc ont été utilisés. DEFRA procède toujours à l’évaluation de ces informations pour voir comment la population du Sahara Occidental en a bénéficié « .La déclaration répond à la question suivante du parlementaire Mark Williams (libéral démocrate), « de demander au Secrétaire d’État à l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales l’évaluation qu’elle a faite de la preuve présentée par la Commission européenne sur la question de savoir si le peuple sahraoui ont été consultés sur leurs souhaits concernant l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche UE-Maroc. »Le bureau juridique des Nations Unies a conclu que les activités sur les ressources naturelles au Sahara Occidental sont en violation du droit international si les Sahraouis n’ont pas été consultés.Télécharger ici l’avis juridique de l’ONU. Lire les conclusions sur la droite.Les services juridiques du Parlement Européen, et l’auteur de l’Avis juridique de l’ONU ont reconnu que la pêche de l’UE est illégale, puisque la volonté des Sahraouis n’a pas été prise en compte.Plus de 100 résolutions de l’ONU, et la Cour internationale de justice, répètent le droit du peuple Sahraoui à l’autodétermination et, dans ce cadre, à la souveraineté sur ses ressources naturelles. En 2010, la Cour a répété le droit des peuples colonisés (non autonomes) à l’autodétermination, dans son avis consultatif sur l’indépendance du Kosovo.WSRW, 6 mai 2011.SaharaDoc, 08/05/2011 -
La réouverture de la frontière entre rumeur et réalité
Depuis la petite phrase lâchée par le président Bouteflika à Tlemcen, lors de l’ouverture de la manifestation culturelle Tlemcen capitale de la culture islamique : «[…] Il n’y a pas de problème entre le Maroc et l’Algérie», les supputations vont bon train du côté de la rue marocaine qui croit dur comme fer que la réouverture de la frontière aura bientôt lieu.Des dates sont avancées : le 16 mai pour certains, le 17 mai pour d’autres. Du côté algérien, c’est le black-out. Personne n’a osé remettre en cause cette information qui circule comme une traînée de poudre au Maroc, ces derniers jours. Les déclarations du président Bouteflika ont été interprétées comme pour confirmer les informations rapportées ces derniers temps dans la presse selon lesquelles «des contacts au sommet» entre Alger et Rabat ont eu lieu.
Pourtant, la question de la réouverture des frontières ne peut être abordée comme s’il s’agissait d’une simple procédure administrative ou d’une volonté politique partagée. L’ex-ministre de l’Intérieur, Yazid Zerhouni, avait bien rappelé aux dirigeants marocains que le problème de la circulation (des biens et des personnes) aux frontières (entre l’Algérie et le Maroc) «ne peut être dissocié d’une approche globale de ce que nous voulons faire de notre Maghreb». Un contentieux existe entre les deux pays concernant les terres et les biens d’Algériens spoliés en 1975 par le roi Hassan II lors des événements d’Amgala. De plus, les autorités algériennes ne cessent d’affirmer que le problème ne se situe pas seulement au niveau de la simple réouverture de la frontière. Aux appels directs et incessants des responsables marocains de lever cet obstacle majeur, les autorités algériennes répondent en chœur que le problème ne se situe pas seulement au niveau de la simple réouverture des frontières, mais d’une question qui mérite largement un vrai tour d’horizon à la faveur des dernières évolutions survenues dans la région, et plus particulièrement les événements en Tunisie et en Libye qui risquent de déborder sur les deux pays et l’insécurité grandissante dans la zone du Sahel où le terrorisme transfrontalier tente de s’implanter avec tout son lot de «désagréments sécuritaires». Le dernier attentat terroriste en date, celui de Jamaâ El-Fna à Marrakech, repose la question de la coopération sécuritaire, même si les deux pays ont commencé dès l’année 1998, à travers leurs services de renseignement, à travailler ensemble. Du côté algérien, les déclarations d’intentions se succèdent à un rythme effréné. Le 25 avril dernier, le ministre de l’Agriculture, Rachid Benaïssa, a déclaré que la frontière terrestre entre les deux pays fermée depuis 1994 sera rouverte «tôt ou tard». Les sorties médiatiques se succèdent sur cette question : signe évident d’un dégel des relations politiques entre le royaume marocain et l’Algérie. Dans une interview parue dans les colonnes du quotidien Echourouk, le ministre des AE, Mourad Medelci, a indiqué que «lorsque la décision sera prise, elle sera appliquée d’une manière honnête et équilibrée, dans l’intérêt des deux parties. On peut y arriver en poursuivant les consultations entre les deux parties. Cela a été entamé il y a trois mois, et nous nous sommes entendus pour continuer l’échange de visites dans des secteurs sensibles. Des visites qui vont continuer jusqu’à la fin de l’année», a-t-il confié au journal arabophone. Le ministre est revenu sur le sujet, mais cette fois-ci sur la chaîne de télévision France 24, d’expression arabe, où il a admis pour la première fois depuis plus d’une décennie que des efforts «étaient actuellement consentis par l’Algérie et le Maroc, et qu’ils s’inscrivaient dans le cadre de l’instauration d’un nouveau climat positif à même de favoriser la dynamisation des relations entre les deux pays».
Mahmoud TadjerLe JeuneIndépendant, 09/05/2011 -
Un cercle vertueux au Maghreb?
Il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui ressort de la fécondité du printemps des peuples dans les pays arabes. Quelque chose qui arrive aussi après une très longue patience, un très long temps de souffrance et d’humiliation.Cela se déroule sur deux axes :1) D’une part, la jeunesse marocaine du Mouvement du 20 février n’a pas faibli devant le défi sécuritaire représenté par l’attentat du 28 avril au café Argana de Marrakech. Ainsi le rapporte Nadjia Bouaricha, l’envoyée spéciale du journal algérien El Watan à Marrakech :« Demain encore [dimanche 8 mai], ce sera au tour des animateurs du Mouvement du 20 février qui ont appelé non pas à un rassemblement devant le café Argana, mais à une marche dont le slogan sera “Le peuple tient au changement et dit non à la violence”. […] La revendication majeure pour une monarchie constitutionnelle semble un bien précieux objectif que les Marocains ne veulent pas voir partir en fumée ou voir passer juste comme une hirondelle de printemps. »2) D’autre part, on le sait peu en France en dehors des milieux du foot (et encore ils ont beaucoup de chats à fouetter en ce moment…) : il y a un match retour Maroc-Algérie (dans le cadre de la qualification pour la prochaine Coupe africaine des Nations, CAN-2012) qui doit se dérouler le 4 juin prochain, à Marrakech justement.Et, à cette occasion, on découvre que les relations Algérie-Maroc se réchauffent à vive allure ! J’en veux pour preuve les déclarations du ministre algérien de la Jeunesse et des Sports, présent la semaine dernière à Marrakech : «quel que soit le résultat, les deux peuples se [doivent] de célébrer le vainqueur, du moment que c’est une équipe du Maghreb». De son coté, son homologue marocain a indiqué que le Maroc avait une dette par rapport à l’exceptionnel accueil offert par les Algériens à Annaba lors du match aller, le 27 mars. «Nous avons à rembourser notre dette lors du match de juin», a-t-il affirmé. Un assaut d’amabilités qui, pour être officielles, n’en sont pas moins nouvelles !Mais, plus encore, il y a les paroles des Marrakchis qu’a rencontrés l’envoyée spéciale d’El Watan. Marrakech bruisse en effet d’une grosse rumeur : la réouverture imminente de la frontière terrestre avec l’Algérie (fermée depuis 1994, quand les deux pays s’envoyaient à la figure la responsabilité d’attentats djihadistes sur leur sol). Cette ouverture de la frontière a d’abord été réclamée par le Maroc, à partir de 2008, pour mettre fin à une situation dépassée correspondant à la décennie du terrorisme islamique en Algérie. Refus d’Alger, qui voulait lier cette réouverture éventuelle à un traitement global de la situation au Maghreb, incluant le règlement du conflit du Sahara Occidental vieux de plus de 30 ans. Jusque dans ce refus de l’ouverture de la frontière avec le Maroc, qui représente pourtant des retombées économiques importantes (sans doute plus pour Rabat que pour Alger), l’Algérie a toujours soutenu les Sahraouis. Aujourd’hui, il semble que les choses changent tactiquement. Cette rumeur d’ouverture a l’air sérieuse. Mais je ne crois pas un instant qu’elle signifie un lâchage des Sahraouis par les Algériens. Je crois qu’elle signale le passage à une approche plus subtile de l’ensemble maghrébin, où on s’appuie davantage sur la maturité et l’empathie des peuples.Car, malgré l’exacerbation des sentiments nationalistes plus ou moins haineux envers les Algériens suscitée par l’affaire du Sahara (une construction diabolique de Hassan II, en 1974, alors qu’il venait d’essuyer 2 tentatives de coups d’Etat, et dans laquelle il a réussi à entraîner toute la classe politique marocaine), on rencontre chez les Marocains du respect, voire plus, à l’égard de leurs voisins. Tels sont les propos recueillis par l’envoyée spéciale d’El Watan : « Sachez que les Algériens sont les bienvenus. Vous êtes nos frères. Nous voulons vous reprendre dans nos bras comme nous le faisions auparavant. » (Amal Karioune, président de l’Association régionale des agences de voyages de Rabat) «Qu’on le veuille ou pas, nous sommes voisins pour la vie. On ne peut pas changer la géographie ni les peuples. Nous sommes obligés de vivre ensemble et, à nous deux, nous sommes capables de faire beaucoup de choses», dit un autre voyagiste.Bien sûr, il peut s’agir de propos de circonstance, suscités par l’espoir de rentrées touristiques liées au match…Mais je retiens dans ces propos deux choses : le réalisme de « nous sommes voisins pour la vie » et la nostalgie de « Nous voulons vous reprendre dans nos bras comme nous le faisions auparavant. » Car il y a eu un avant, quand les peuples marocains et algériens étaient vraiment frères, et aussi leurs élites, au temps de la lutte pour l’indépendance, et dans la décennie qui a suivi. Je me souviens de ce couple de professeurs algériens rencontrés au début des années 70 sur une plage à Mohammedia ou à Salé : ils étaient là en vacances, très naturellement, comme depuis plusieurs années, et me disaient l’accueil chaleureux qu’ils avaient rencontré à chaque fois et qui les faisaient revenir au Maroc.Il y a aussi la solidarité qui liait un Ahmed Ben Bella, alors président de la jeune république algérienne, et Mehdi Ben Barka, l’opposant marocain à Hassan II obligé de s’exiler, dont Ben Bella fit, dit-il, son « ministre des Affaires étrangères bis » pendant plusieurs années. (Voir le documentaire de 15 minutes environ diffusé par le site marocain lakome.com, lien ci-dessous, Ben Bella parle vers la cinquième minute :Nostalgie donc, mais qui fonde un espoir. Y compris pour les Sahraouis. Car je ne vois pas que deux peuples puissent s’entendre sur le dos d’un troisième. Ce genre de trahison est plutôt le propre de dirigeants…Aïe ! La vigilance reste donc de rigueur…Mediapart, 08/05/2011 -
Dominique Vidal « Une intifada contre soixante ans d’humiliations »
Journaliste au Monde diplomatique, Dominique Vidal vient de publier avec Alain Gresh une nouvelle édition des 100 clés du Proche-Orient, ouvrage de référence qui éclaire les répercussions du conflit israélo-palestinien dans des pays dont l’histoire tourmentée revient ces jours-ci à la une de l’actualité : Yémen, Syrie ou Jordanie.Cette nouvelle édition sort à point nommé car on peut y trouver bien des clés pour comprendre ce qui se passe dans les différents pays. Une large place y est consacrée au conflit israélo-palestinien. Or, curieusement, bien que la question palestinienne soit centrale dans l’histoire de ce dernier siècle au Proche-Orient, elle a quasiment disparu des médias ces temps-ci. Pourquoi ?Dominique Vidal. C’est un phénomène connu de la couverture médiatique : l’événement le plus brûlant prend le dessus, les autres sont éliminés, jusqu’à ce qu’un autre événement ailleurs vienne à la une et ainsi de suite. C’est regrettable, mais c’est ainsi. Je crois pourtant que ce qui se passe dans le monde arabe va modifier la donne en Palestine. Quand on parle du Proche-Orient et du Maghreb, tout se tient et c’est très difficile d’isoler le « printemps arabe », expression que j’aime bien, de l’hiver arabe. Je pense qu’il y a dans tout événement important de l’histoire – et c’en est un – des causes multiples. Toute explication monocausale est analphabète, a fortiori quand il s’agit d’événements populaires aussi puissants et spontanés. Personne ne peut prétendre qu’il y avait derrière cette succession de soulèvements un grand organisateur ni je ne sais quel complot.Parlez-nous de ces causes, que vous abordez en ouverture du livre.Dominique Vidal. Les causes immédiates sont la misère, l’arrogance des puissants et des corrompus. Dans cette région qui produit un tiers du pétrole mondial et qui en détient les deux tiers des réserves, un habitant sur cinq survit avec moins de 2 dollars par jour. Le nombre de personnes sous-alimentées est passé en quinze ans de près de 20 millions à plus de 25 millions, le pourcentage officiel de chômeurs est de 15 % mais en réalité il est bien plus élevé, sans doute plus du double. 23 % des plus de quinze ans sont analphabètes, 17 % illettrés. La croissance moyenne du PIB entre 1980 et 2004 n’a pas dépassé 0,5 % par an. C’est donc une région de grande richesse potentielle, mais où l’arrogance des puissants et des corrompus qui en profitent contraste avec la misère de couches de plus en plus larges. Le dernier rapport du PNUD en 2009 montre que c’est la seule région du monde qui non seulement n’a pas progressé, mais a régressé dans toute une série de domaines au cours des vingt dernières années. À cela s’ajoute l’aspect dictatorial, les services de renseignements, la torture, etc. On le disait peu, car c’était des amis de l’Occident qui étaient au pouvoir, mais au Caire on se faisait arrêter pour n’importe quoi, même sans raison, et on était torturé dans un commissariat. J’ai des amis qui ont été témoins de ce genre de choses. Cela explique l’explosion. Mais ce sont seulement les causes immédiates. L’explication plus profonde est à chercher dans l’histoire : le printemps arabe est une intifada contre soixante ans d’humiliations en tous genres.Intifada, comme en Palestine ?Dominique Vidal. Oui. Intifada veut dire, au sens littéral, relever la tête. Pour moi, ces humiliations ont commencé avec la Nakba. En 1948 la Palestine disparaît, 800 000 de ses habitants sont expulsés, manu militari souvent, comme les nouveaux historiens israéliens l’ont confirmé. Cela crée une spirale de guerre : on a dix guerres générales dans cette région depuis 1948, 1956, 1967, 1973, 1982, 2006, 2009 – si on peut appeler cela une guerre : 13 morts du côté israélien et 1 400 à Gaza. Sans oublier les métastases que sont les deux guerres du Golfe et la guerre en Irak, la guerre civile libanaise, résultats de ce tohu-bohu, mot hébreu qui dit bien ce qu’il veut dire : chaos. Cet état de guerre entre Israël et les pays arabes a eu des conséquences sur ce qui se passe aujourd’hui.Lesquelles ?Dominique Vidal. D’abord, toutes les richesses détournées vers la course aux armements au lieu d’être investies dans le développement. Ensuite, l’état de guerre a été le prétexte idéal pour installer des dictatures : face à « l’ennemi sioniste » il fallait serrer les rangs. Quiconque n’était pas d’accord avec tel ou tel régime était un allié d’Israël. Enfin, l’échec des régimes baasistes – qu’il faut relativiser car ils ont apporté bien des acquis sociaux qui comptent encore aujourd’hui, au moins dans la mémoire des gens – est directement lié au conflit avec Israël. Nouvel échec d’ailleurs, quand les pays arabes sont entrés dans la mondialisation – avec notamment l’Infitah de Sadate, la libéralisation de l’économie qui n’a profité qu’à une toute petite catégorie sociale. On voit où tout cela a mené. Le terreau de l’intifada d’aujourd’hui, du printemps arabe, s’enracine bien dans cette histoire.Comment cela peut-il modifier la donne en Palestine ?Dominique Vidal. Avant le geste de Mohamed Bouazizi, la situation était totalement bloquée. Il n’y avait rien à attendre du gouvernement israélien, le plus extrémiste de l’histoire d’Israël. Rien à attendre côté palestinien du fait de la division Fatah- Hamas, dont les deux directions ont une responsabilité dans l’impasse et dans le refus de la surmonter. Le monde arabe gardait le silence le plus total depuis son offre positive de 2002 à Beyrouth. Du côté des États-Unis et de l’Union européenne, on assistait à un théâtre d’ombres : Obama a fait un discours magnifique au Caire, mais on n’a jamais vu ce discours se traduire en actes. L’Union européenne, avec son hypocrisie habituelle, faisait aussi de beaux discours : État palestinien, retrait des territoires occupés, arrêt de la colonisation, etc. On ne peut rêver mieux que la déclaration de l’UE du 8 décembre 2009. Sauf que le 8 décembre 2008, elle avait approuvé le rehaussement des relations avec Israël. Après Gaza, on n’a plus osé le dire tout haut, mais chaque mois on signe un nouvel accord. C’est le rehaussement rampant. Israël obtient ainsi peu à peu tout ce qu’il veut sans respecter aucune des exigences ni d’Obama, ni de l’ONU, ni de l’Union européenne. Le printemps arabe change la donne et on le voit déjà.En quoi exactement ?Dominique Vidal. Israël n’a plus ce qui était l’un des piliers principaux du statu quo : après avoir écrasé ses voisins arabes en 1967 dans une guerre préventive planifiée, il avait réussi à faire des paix séparées avec l’Égypte puis avec la Jordanie. Il était à l’abri de sa hantise : une guerre sur tous les fronts. Les régimes égyptien et jordanien étaient complices de ce statu quo. Le printemps arabe sape ce pilier. Sans doute, les dirigeants égyptiens et jordaniens ne vont pas déchirer les traités de paix. Mais je pense que l’ère de la complicité active est terminée. Vu la mobilisation de l’opinion et l’immense appel à la dignité que représentent ces mouvements, Israël va se retrouver plus isolé que jamais.Le deuxième élément, c’est que le printemps arabe, comme le nuage de Tchernobyl, ne s’est pas arrêté aux frontières de la Cisjordanie et de Gaza. Il y a déjà eu des manifestations de jeunes importantes, à Ramallah et à Gaza, sur le thème « Dégage Hamas, dégage Abbas ». Le Hamas a envoyé ses nervis cogner sur les jeunes. Le Fatah a apporté sa sono pour pousser des mots d’ordre en faveur de l’unité, qui ne déplaisaient pas aux jeunes manifestants. Je ne pense pas que ce soit un hasard si, au beau milieu du printemps arabe, Mahmoud Abbas propose des élections législatives et présidentielle d’ici à la fin de l’année et si le Hamas après avoir dit non dit « on peut discuter ». Des deux côtés on voit bien qu’on ne peut pas continuer à entretenir la division. L’aspiration populaire est telle – même si les gens sont plus las qu’ailleurs, un peu comme en Algérie où ils sortent de vingt ans de guerre civile – que cette division qui arrange si bien Israël a des chances de se résorber.Troisième point, il y a une dimension mondiale du printemps arabe. Depuis la chute du mur, il y avait une sorte de résignation mondiale. Comme si les gens avaient cru Fukuyama et sa fin de l’histoire. Les Américains faisaient ce qu’ils voulaient quand ils voulaient. Sauf qu’il y a eu l’échec en Irak, en Afghanistan, et maintenant ce printemps arabe qui les prive de certains de leurs alliés traditionnels. On assiste à une bascule des rapports de forces mondiaux : la Chine, la Russie, l’Inde, la Turquie, le Brésil… Et Obama est là pour essayer de gérer cela, de regagner un peu de terrain.Cela ne peut pas être une coïncidence si au moment se où produit cette vague énorme et qui va durer, car c’est un mouvement de fond, on voit l’ONU se poser la question d’accueillir l’État de Palestine à la prochaine Assemblée générale, en septembre 2011, dans les frontières de 1967 et avec Jérusalem-Est pour capitale. En 1988, quand le Conseil palestinien d’Alger avait proclamé l’État de Palestine, 110 États l’avaient reconnu, essentiellement d’Asie et d’Afrique. Depuis trois mois on a une vague de reconnaissances formelles par la quasi-totalité des États latino-américains, sauf la Colombie. Pour cause : le régime israélien est l’un des alliés les plus efficaces de la dictature colombienne.En Europe, le 13 décembre, le sommet de l’UE a dit : « On le reconnaîtra le moment venu. » Or, le nouveau ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, vient de dire, le 15 mars : « Nous n’en sommes pas là mais c’est une hypothèse qu’il faut avoir en tête, avec les autres pays de l’Union. »Évidemment, le printemps arabe place les Occidentaux devant un dilemme cornélien : s’ils ne passent pas des paroles aux actes, ce bouleversement des rapports de forces risque de se concrétiser, et ils risquent d’être battus à l’Assemblée générale avec une écrasante majorité qui vote l’admission de l’État de Palestine. Et que fera le Conseil de sécurité ? En fait, plus un seul État au monde, sauf Israël, n’est opposé à l’admission de l’État de Palestine. Prendre le contre-pied de cela est un risque énorme, même pour les États-Unis.Pour revenir à l’actualité du printemps arabe, n’y a-t-il pas une exception libyenne ? C’est plutôt une guerre civile qu’une révolution.Dominique Vidal. Oui, car la Libye n’est pas une nation comme les autres nations arabes. Ailleurs, il y a des nations constituées à travers l’histoire. Même au Maghreb, où le colonisateur a divisé, séparé, mais en constituant malgré lui des réalités spécifiques qui sont le Maroc, l’Algérie, la Tunisie. Il a oublié, malheureusement, le Sahara occidental, qui est un facteur de désunion et sur lequel l’Union européenne montre la même hypocrisie que pour la Palestine. On en est à renier les textes même des Nations unies, à renoncer au référendum, à laisser le Maroc coloniser dans des conditions hallucinantes. La Libye, contrairement aux autres pays du Maghreb, ne s’est forgé ni identité nationale ni réalité étatique. C’est une addition de clans. Le pouvoir de Kadhafi est simplement celui d’un clan sur les autres. Chavez et ses amis se trompent complètement, car ils continuent à voir en lui le révolutionnaire qu’il n’est plus depuis longtemps. Il est devenu depuis 2002 un allié fidèle de l’Occident et son agent du maintien de l’ordre en Afrique.Pourquoi, alors, Sarkozy l’a-t-il attaqué ?Dominique Vidal. Parce que cela devenait intenable et que notre président de la République avait besoin de se refaire une santé sur le plan international. Et puis, il y a une résolution de l’ONU. Ce qui intrigue, c’est le fait que Ban Ki-moon n’ait pas essayé de négocier pour éviter le recours à la force, comme l’avait fait Perez de Cuellar avec Saddam Hussein en 1990. Le danger de cette intervention, à mon avis, c’est celui d’une division du pays, risque de division qui n’existe pas dans les autres pays arabes, à l’exception du Yémen, où il y a aussi des divisions tribales, régionales et religieuses. À mon avis, il n’y avait pas de bonne solution. Ne pas intervenir, c’était, outre le probable massacre de milliers de gens, le risque d’un coup d’arrêt au printemps arabe. C’était fini pour le Bahreïn, la Syrie aussi sans doute. Mais le fait que l’Otan reprenne les choses en main est inquiétant. Il y a matière à un débat, qu’il faut mener de sang-froid en tenant le plus grand compte des souffrances des populations. À mon avis, toutes les solutions étaient mauvaises : intervenir et ne rien faire.Y a-t-il un risque de voir les choses tourner mal en Syrie ?Dominique Vidal. Je ne pense pas. En Syrie, même chez les opposants, il y a un certain respect pour le chef de l’État. Il ne s’est pas rendu indigne comme un Ben Ali ou un Moubarak. Il y a un certain respect pour la stature internationale de la Syrie, qui n’est pas devenue le larbin de l’Occident. Mais il y a évidemment beaucoup à dire sur le système dictatorial et la corruption, dans ce pays comme dans tous les autres. C’est pour y mettre fin que, là aussi, les gens manifestent. Et ce qui est extraordinaire, c’est que tous ces mouvements sont un démenti cinglant de ce que Huntington présentait comme un conflit de civilisations. C’est même tout le contraire : ces révolutions se font au nom des principes universels qui sont aussi les nôtres : liberté, égalité, solidarité et justice.Les 100 clefs du Proche-Orient, Alain Gresh et Dominique Vidal, éditions Pluriel, 750 pages, 17 euros.

